Contre qui se battre ? La mort des institutions
« Autant il est facile de détruire et de brûler par une journée d’émeutes tous les édifices privés et publics, autant on peut, par le discours en quelques minutes d’une personnalité de la république, truffé de contre-vérités, détruire tous les équilibres sociaux. Le culte de la personnalité, la médiocrité, le clientélisme, la corruption et le népotisme prennent racine pour remplacer toute idée d’institutions crédibles dans la gestion des affaires de la cité. »
Quels freins retardent la marche des nations considérées comme pauvres, alors qu’elles disposent de toutes les cartes pour être prospères ?
Le déclin des institutions nationales est, selon l’auteur, une des raisons de ce ralentissement mais, une fois restaurées, elles peuvent également devenir un outil clé pour l’avenir.
Avec cette réflexion politique et sociale, Mayoro Mbaye décortique les penchants destructeurs de l’humanité et ouvre des portes sur l’espoir d’une société saine, encline à la vérité.
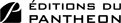


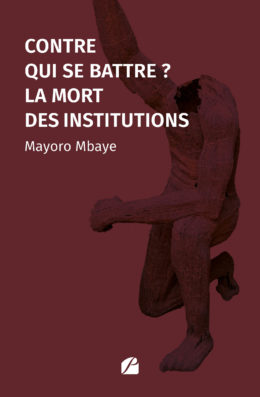

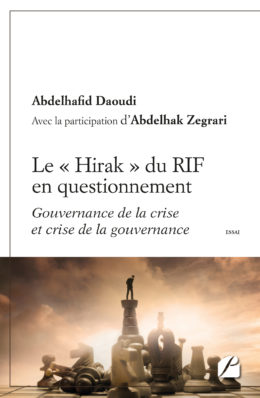

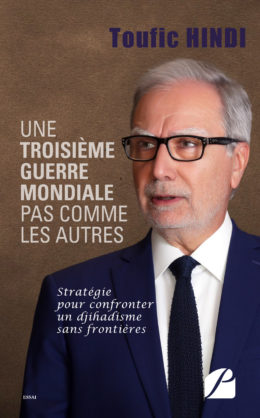
Commentaires récents