Les politiques juridiques des États d’Afrique de l’Ouest en matière de contrôle des sociétés minières
« Le contrôle des sociétés minières par les États était au centre des revendications ayant pour objet la souveraineté permanente sur leurs ressources naturelles. De même, la libéralisation du secteur minier et le renoncement à ce contrôle constituaient inversement des objets essentiels des réglementations minières des années 1980 adoptées dans le cadre des programmes d’ajustement structurel. »
Dans les droits miniers des États d’Afrique de l’Ouest, les mines appartiennent à l’État. Celui-ci est donc titulaire des pouvoirs de dominium et d’imperium ; pouvoirs qui lui confèrent le droit de concéder l’exploitation de ses ressources et de veiller à ce que sa politique de développement soit prise en compte par chaque société titulaire d’un titre minier.
À l’égard de ces sociétés minières, le rôle de l’État ne se limite pas à l’exercice de son pouvoir normatif et de régulation. Il se traduit aussi par le contrôle qu’il exerce, du moins, qu’il cherche à exercer en leur sein. Ce contrôle est de caractères capitalistique et non capitalistique. L’essai rend compte de l’insuffisance et de l’inefficacité de ces contrôles qui privent les États de la pleine maîtrise et de la mobilisation des ressources minières pour leur développement.
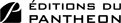



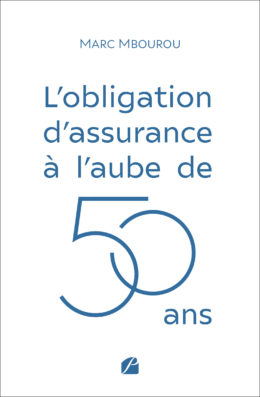
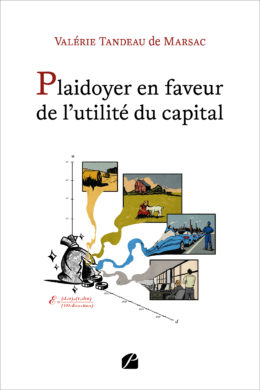

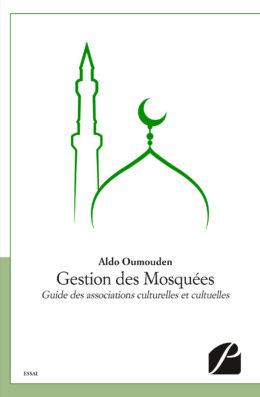
Commentaires récents