L’aigle et l’aspic : le pouvoir des Ptolémées (305-180 av. J.-C.)
« L’idée d’étudier l’idéologie royale chez les Ptolémées est née de cette rencontre, celle du beau et du grandiose, de la curiosité et de la passion : en un mot, de l’envie de faire vivre à nouveau ces rois du Nil à l’histoire époustouflante de grandeur, mais aussi de décadence.»
Leur empire s’étendait de l’Égypte à l’Asie Mineure. La dynastie des Lagides, les descendants du général macédonien Ptolémée, a bâti quelques-unes des merveilles du monde antique : le grand phare et la bibliothèque d’Alexandrie.
Rois grecs, ils régnèrent près de trois cents ans sur l’Égypte, jusqu’à leur dernière représentante : Cléopâtre, septième du nom, dont la légende dit qu’elle se donna la mort en laissant une vipère aspic la mordre.
Cet essai invite à un voyage documenté à la rencontre des premiers Ptolémées et à la fondation de leur pouvoir.
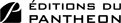


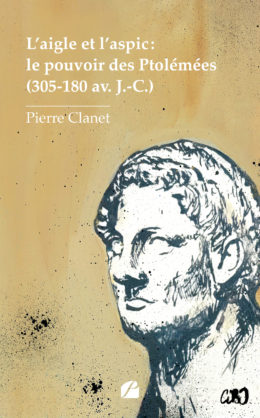
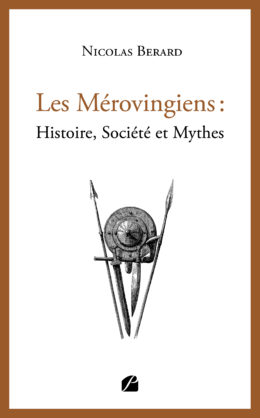
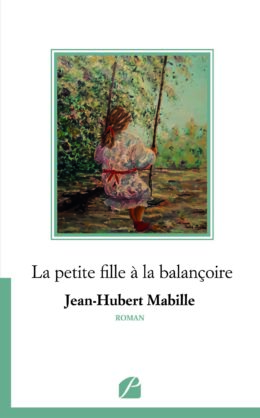
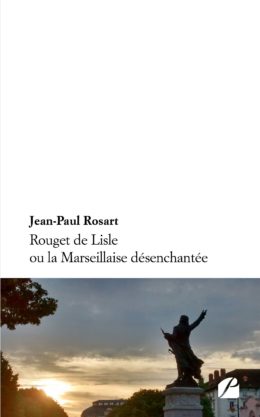
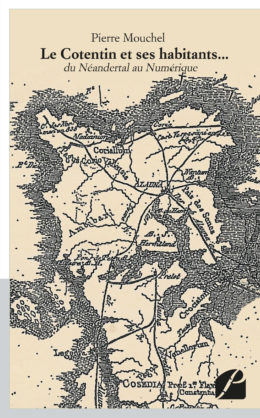

Commentaires récents