Études comparatives de politiques publiques
« Au cœur de ce livre résident une question et un défi persistants : comment pouvons-nous comprendre, analyser et évaluer les politiques publiques de manière holistique, en tenant compte des multiples nuances nationales et des variables qui influencent ces processus complexes ? »
Destiné à un public varié, depuis les chercheurs jusqu’aux administrateurs, cet essai examine comment les contextes institutionnels, culturels et historiques influent sur la formulation et la mise en œuvre des politiques publiques nationales. Allant au-delà d’un simple guide méthodologique, l’ouvrage invite à la réflexion et à l’action, encourage les lecteurs à appliquer ces dispositifs dans leurs propres recherches pour enrichir leur compréhension dans un monde complexe et dynamique. Ainsi, il constitue une ressource précieuse pour ceux qui naviguent dans le domaine exigeant des politiques publiques comparées.
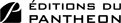



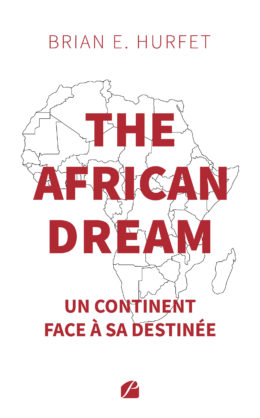
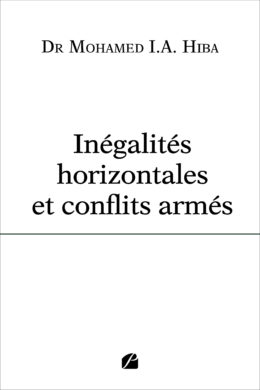
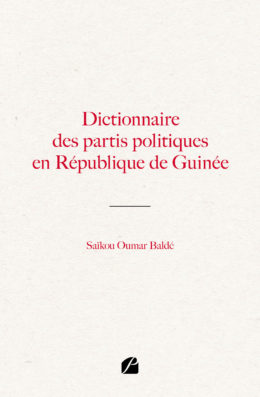
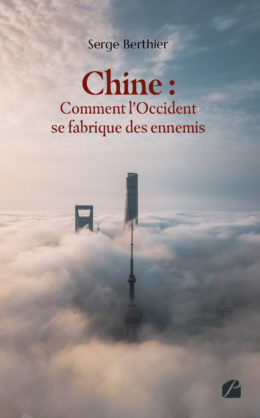
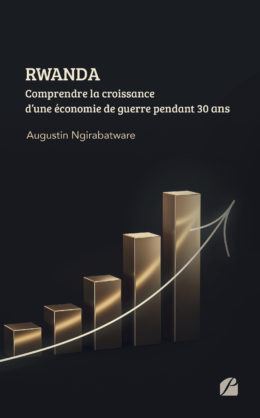

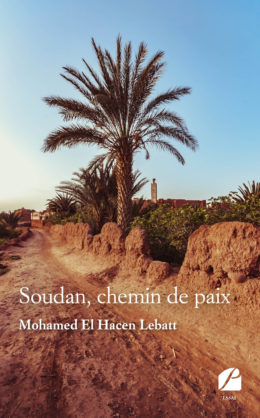
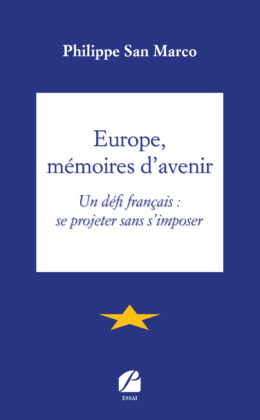

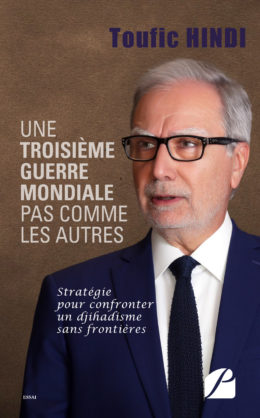
Commentaires récents