Dédée
« Aujourd’hui, voici donc, pour les plus jeunes, l’histoire d’une héroïne dont ils ne savent rien de rien, dont ils n’ont jamais entendu le nom, mais qui reçut de la France la Croix de guerre et fut promue chevalier de la Légion d’honneur à titre posthume. »
Qui était véritablement Andrée de Rochevieille ?
Ce destin du XXe siècle, cette jeune fille rebelle aux valeurs de sa famille, infirmière héroïque pendant la « drôle de guerre », résistante indomptable, meurt tragiquement à 28 ans, à l’aube de la Libération…
Plusieurs fois décorée, citée à l’ordre de la Nation, elle est pourtant engloutie dans l’oubli familial. Pourquoi ? Comment ? Que s’est-il passé ? Il n’y a ici ni « bons » ni méchants… Mais tant de questions !
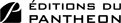


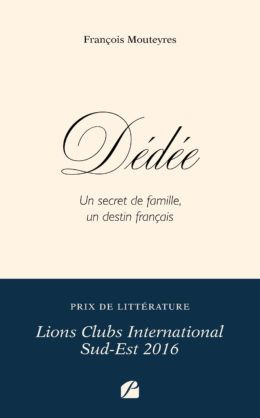
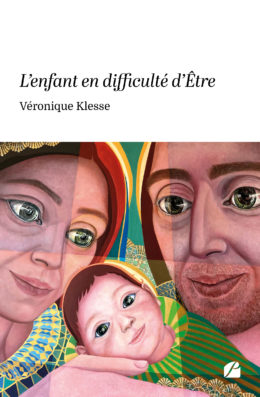
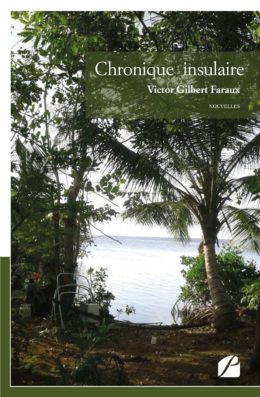
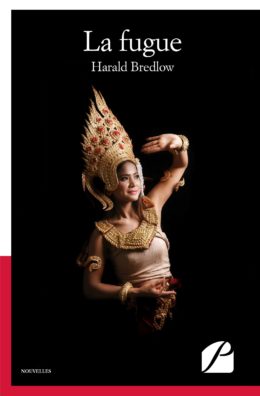
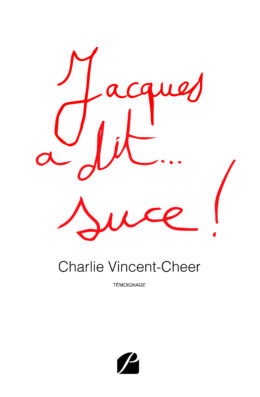
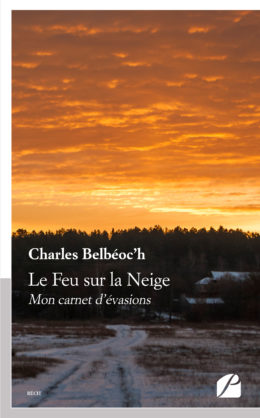
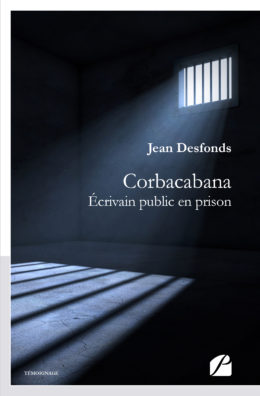
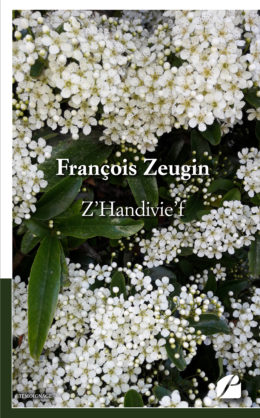
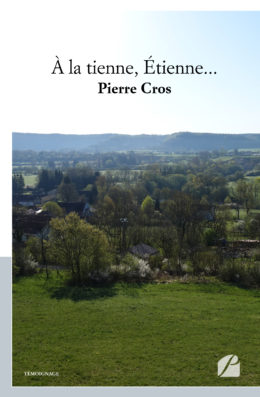
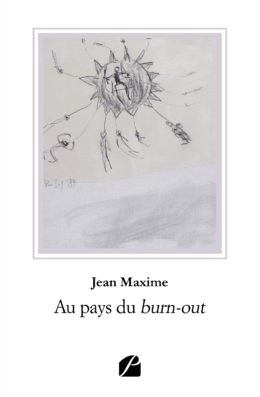
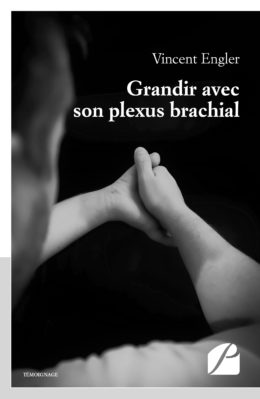
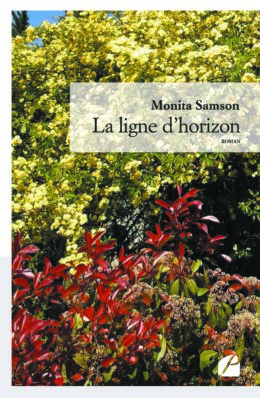
Commentaires récents