Éducation bienveillante du cheval et de l’être humain : l’effet miroir
« Le véritable homme de cheval ne connaît ni la peur (contagieuse, génératrice de méfiance, de brusquerie et d’autoritarisme, dans tous les cas mauvaise conseillère), ni la colère (qui affole l’animal, ferme sa compréhension et détruit la relation), ni l’impatience, cette exigence contre-productive qui voudrait que le cheval réagisse comme une mécanique. Or appréhension, colère et impatience mangent souvent à la même table et engendrent immanquablement montée en tension et perte de contrôle.
Ces considérations équestres s’appliquent à tous les êtres hu-mains. Colère et impatience en particulier sont les outils de prédilection de l’ego et sont rarement constructives. »
Établir un parallèle entre éducation d’un petit d’homme et celle d’un équidé, c’est l’idée originale voire iconoclaste que l’auteur développe dans cet essai.
Ces deux formes d’éducation se rejoignent en premier lieu autour de problématiques fondamentales : développer les capacités de l’apprenant, le structurer pour qu’il soit prêt à affronter les activités auxquelles il sera confronté et le socialiser pour qu’il puisse s’intégrer harmonieusement dans son environnement. Autre point commun, la nécessité d’instaurer une relation de sujet à sujet afin que le dialogue entre l’éducateur et l’apprenant soit véritablement fructueux.
C’est finalement à une réflexion approfondie sur l’éducation, les relations humaines et interespèces que nous invite cet essai fascinant.
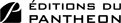




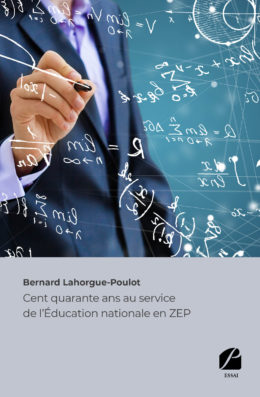
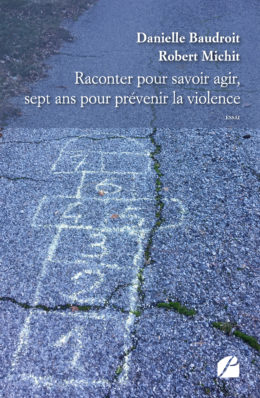
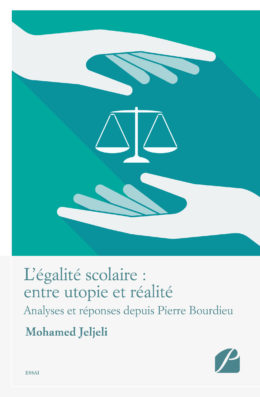
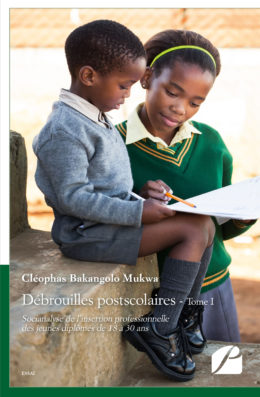
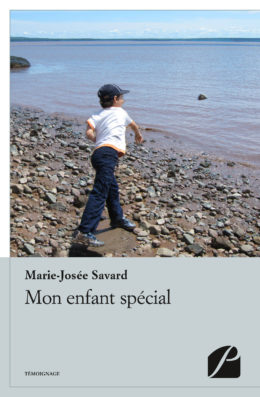
Commentaires récents