Le sens de la vie
Dans un environnement marqué par la prédation des comportements et la recherche stérile des récompenses, la place de l’homme est indéniablement questionnée, et la recherche d’un bien standardisé de civilisation menace d’accomplir un repli sur soi : caractéristique générale du pratico-inerte, du corps sans organe historique.
À l’heure où l’économie et le sens de la propriété prennent le pas sur la solidarité et l’engagement artistique, comment redonner sens à une vie trop émoussée par notre société de normalisation ?
L’alternative est donc posée, entre une adhésion défaitiste au modèle occidental – financier et matérialiste – asphyxié par le spectre de la dangerosité de l’anormal, et un nouvel espoir pour le devenir et l’accomplissement de l’homme fondé sur l’éducation, la créativité artistique et le partage collectif. En somme, une nouvelle exigence sociale et politique, qui refuse le confort et les certitudes du matérialisme pseudo-démocratique, où la place de l’homme s’avère incompatible avec les exigences très lisses du gestionnaire.
S’appuyant sur des références philosophiques et littéraires similaires à son premier essai, Le sens de l’histoire (Sartre, Foucault, Deleuze et Badiou), Christophe Agogué s’attache à positionner l’homme face à ses finalités et ses vérités, au sein d’un monde fragilisé par une crise économique, culturelle et éducative. Perspicace, son message est un appel à un sursaut civique, politique et éthique.
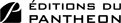



Commentaires récents