Ma première orange
« Souvenir de cette paix retrouvée lors des fêtes de Noël, lorsque ma grand-mère disposa, pour moi, une orange au pied du sapin. Je la croquai à pleines dents et fis immédiatement une grimace devant laquelle tous les adultes se mirent à rire. Ma grand-mère s’empressa de me montrer comment il fallait éplucher ces fruits qui m’étaient encore inconnus, avant de les manger. »
Dans cette autobiographie captivante, Patrice Huguier nous entraîne dans un voyage à travers les décennies, depuis son enfance marquée par la guerre jusqu’à sa vie d’artiste accomplie.
De ses racines familiales à ses années d’adolescence, en passant par les épreuves du service militaire en Algérie, l’auteur livre un témoignage poignant et riche en anecdotes.
Après ses études aux Arts Décoratifs, complétées par les cours du soir de l’École du Louvre et des conférences aux Arts et Métiers, en compagnie de Jean Prouvé, Patrice Huguier a rejoint le Centre Français du Commerce Extérieur au bureau architecture. Il va ainsi parcourir les 5 continents et réaliser la scénographie des pavillons français dans le cadre des Expositions universelles.
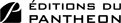


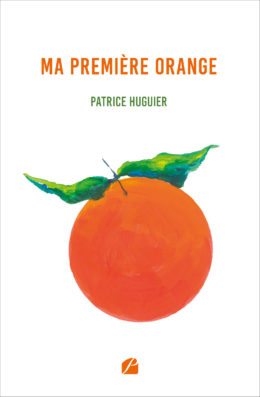
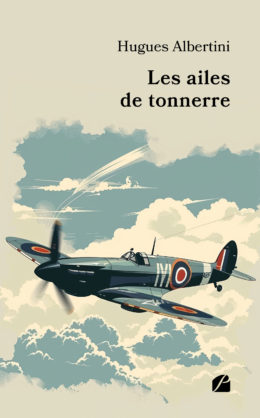
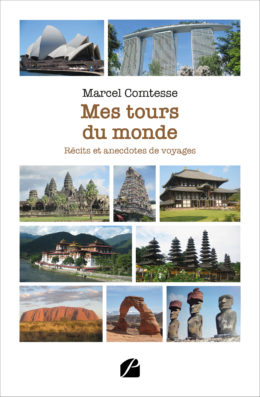

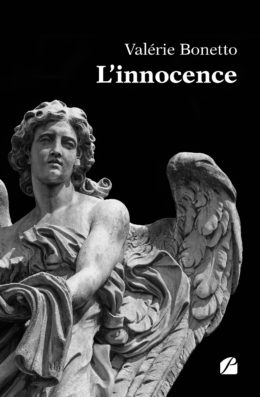
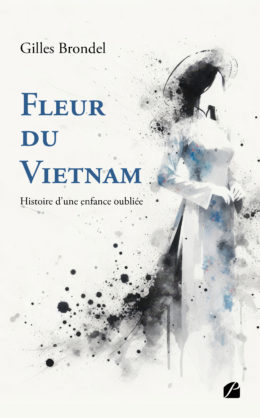
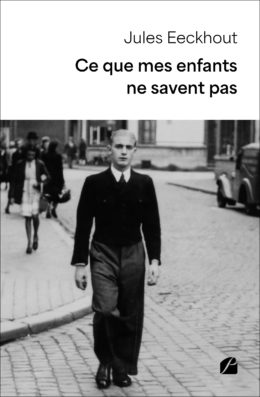
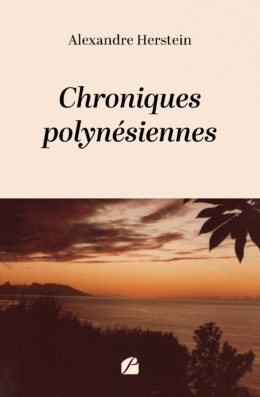
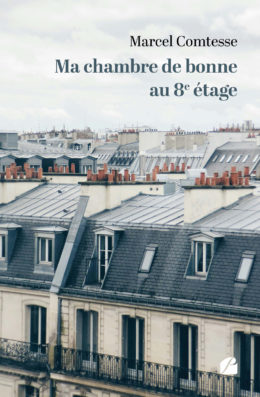
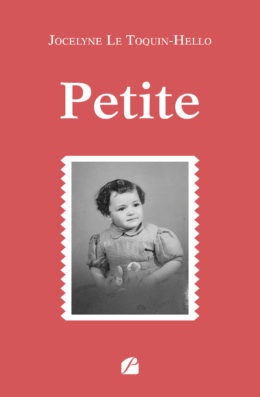
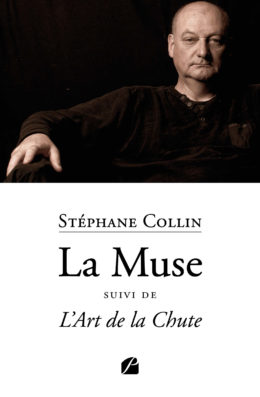
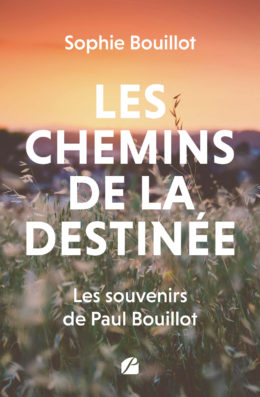
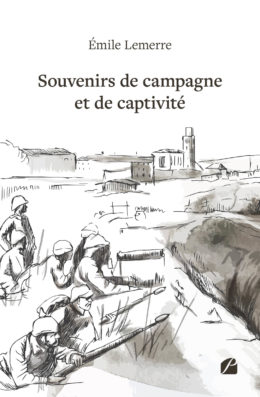
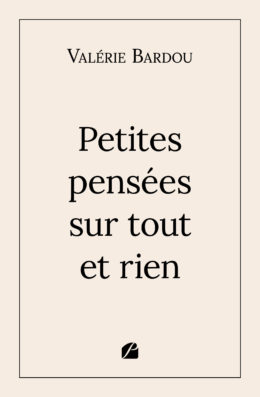
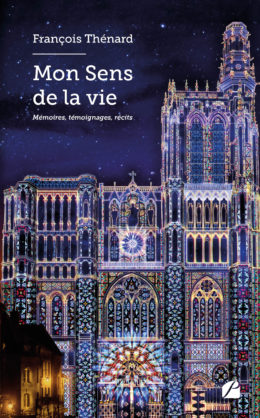
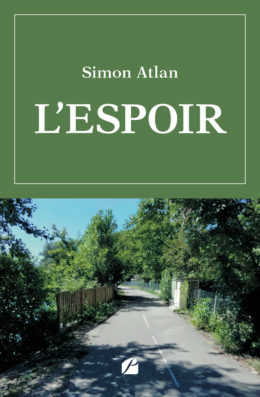
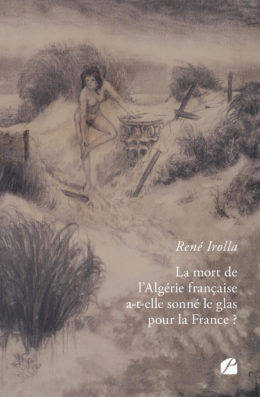
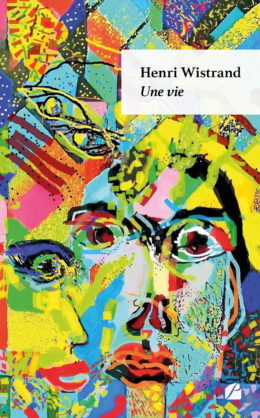
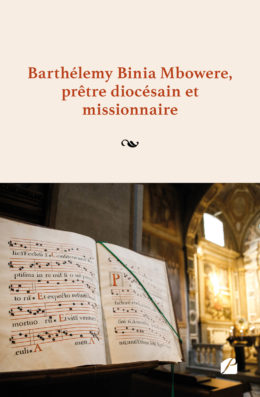

Commentaires récents